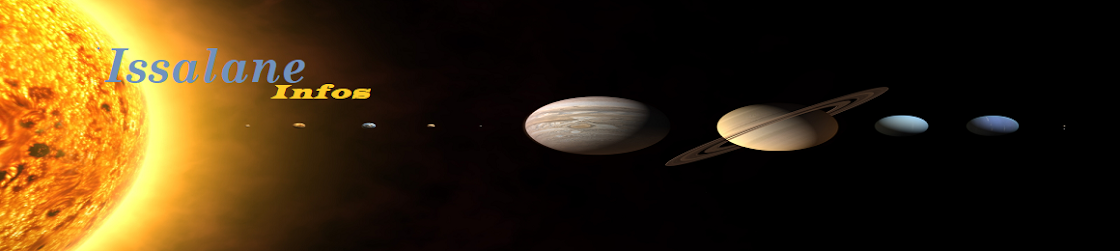Liberation-1° mars 2013
Baigné par la musique touareg, un univers effervescent a vu le jour à l’ombre d’une guerre perpétuelle. L’Américain Christopher Kirkley le restitue dans une compilation atypique.
Les villes évoquées sont d’une actualité terrible : Kidal, Gao, Tombouctou… Des recoins du Mali où commence le sable du Sahara, là où des groupes islamistes imposaient leurs préceptes moyenâgeux depuis plus d’un an. Qui ont vécu, depuis la mi-janvier, une guerre presque sans images, mais baignée par une musique qui en a vu d’autres et aspire aujourd’hui au progrès et à la paix.
C’est là qu’a débarqué en 2009 un Américain téméraire, Christopher Kirkley, à la recherche d’une Afrique de griots, dans des villages poussiéreux, qui n’attendaient que d’être découverts. Quatre ans plus tard, il vient de publier le deuxième volume d’une compilation atypique, Music from Saharan Cellphones, qui prend le contre-pied de cette quête fantasmée pour mettre en lumière les musiques les plus modernes du Sahel, sérieusement remuées par la généralisation des téléphones portables depuis le milieu des années 2000.
De passage à Paris pour inaugurer une exposition sur l’art digital de la sous-région (lire page VII), Chris Kirkley avoue être arrivé dans le désert «par hasard». «Je me passionnais à l’époque pour l’ethnomusicologie, les archives d’Alan Lomax [un Américain qui a enregistré des musiques populaires dans le monde entier entre 1946 et 1967, ndlr]. J’ai choisi l’Afrique comme ça, parce qu’un ami m’avait offert un disque d’Afel Bocoum, un Malien qui a joué de la guitare dans le groupe d’Ali Farka Touré. Je me suis renseigné comme j’ai pu à la bibliothèque, mais il n’y a pas beaucoup de choses en anglais sur le Mali ; pour moi, c’était donc une terre vierge quand je suis parti depuis Paris, en auto-stop, en passant par le Maroc, la Mauritanie, pour finalement atteindre Tombouctou.»
«Trois euros le giga au marché de Nouakchott»
De là, le trentenaire de Portland, qui a appris le français «sur la route», a vadrouillé vers le sud, de Niafunké à Bamako, avant de remonter vers le désert : Gao, puis Kidal. Il passera six mois, entre 2009 et 2010, dans cette zone désertique aujourd’hui disputée entre des milices islamistes et les forces armées françaises et maliennes. «J’étais parti avec un micro et un enregistreur ; mon idée était d’aller découvrir des musiciens traditionnels. Mais à chaque fois, ils me sortaient un téléphone portable pour me faire écouter leurs chansons… Ça me fatiguait, jusqu’à ce que je me dise : « C’est là-dedans que ça se passe désormais. »»
On peut trouver surprenant – voire gênant – de s’extasier devant un bête téléphone portable, mais quiconque a voyagé au Mali sait que ces appareils ont mis du temps à se répandre en masse hors des grandes villes africaines, là où l’accès au réseau reste limité. Importés de Chine, d’Inde et d’Europe via Dakar ou Lagos, ils sont désormais partout, de Bamako aux campements nomades du désert, transformant la façon d’écouter et d’échanger la musique. «Avant, elle circulait sur des cassettes qui se copiaient au fil des déplacements des habitants, et notamment des peuples nomades comme les Touaregs, mais aussi des taxis-brousse, des bus de touristes ou des convois clandestins, raconte Arnaud Contreras, documentariste, auteur de nombreux et beaux reportages radiophoniques et photographiques sur les cultures du Sahel. Comme le CD n’a quasiment jamais existé dans le coin, on est passé directement aux MP3, stockés dans les téléphones portables et qui circulent en tous lieux et tout le temps via le bluetooth. Dans un bus, il n’est pas rare que ton voisin te demande ce que tu écoutes et te propose d’échanger de la musique. La connexion à Internet est lente voire inexistante, donc tout se passe de la main à la main.» Ou plutôt de téléphone à téléphone.
Les musiciens ont vite intégré cette accélération des échanges sans cadre légal aucun, dans une région où l’économie de la musique enregistrée est un fantôme. «On ne vend pas de disques, explique ainsi Monza, un producteur mauritanien qui a fondé le festival Assalamalekoum à Nouakchott. La musique se trouve gratuitement ou s’achète au giga en Mauritanie, comme au Mali ou au Niger. A un moment, les musiciens ont donc délibérément choisi de donner leurs chansons aux vendeurs de téléphones portables, afin qu’ils les diffusent au mieux à leurs clients. Au marché de Nouakchott, la musique se vend aujourd’hui dans les 3 euros le giga.» Chacun se retrouve donc avec une carte mémoire bourrée de centaines de chansons en vrac, au son souvent très compressé afin de prendre le moins de place possible. Un tri darwinien s’opère ensuite au fil des rencontres.
«Si ton morceau plaît, il va se promener très rapidement, poursuit Monza. Ça permet de construire un public.» Et de faire circuler à une vitesse redoutable les nouveautés de Niamey à Tombouctou, de Kidal à Ayoun el-Atrouss (Mauritanie), les téléphones avalant au passage la nationalité des chanteurs et brassant de la pop égyptienne, beaucoup de rap français ou algérien, des gros tubes internationaux type Céline Dion, mais surtout beaucoup de musique touareg, dite ishumar.
Un courant né avec les revendications touregs
C’est sur ce melting-pot technologique qu’est tombé Christopher Kirkley. «Ce qui m’a passionné, dit-il, c’est la métaphore d’un Internet à pied. Les échanges de téléphone à téléphone ont créé un peer-to-peer physique, un réseau d’échanges libres qui fait réfléchir sur la façon dont, en Occident, la course au copyright a verrouillé la culture. Nos idées sur la circulation de la culture dématérialisée sont les mêmes qu’à l’époque du phonographe, alors qu’ici, tout est très différent. Au Sahel, l’échange est roi.» Et tant pis si les artistes ne doivent compter que sur les fêtes et mariages où ils se produisent pour gagner leur vie. De ce brouhaha qui se moque des postes-frontières, l’Américain a rapporté «8 gigas de musique», dont il a tiré deux compilations qui cherchent à témoigner d’un modernisme sonore. On n’oubliera pas, en les écoutant, qu’il s’agit d’une sélection très personnelle qui donne une place surdimensionnée aux boîtes à rythmes et aux claviers, là où la guitare reste l’instrument majeur de la région. Mais les deux volumes de Music from Saharan Cellphones sont, vu de 2013, une passionnante porte d’entrée vers les sonorités en pleine mutation dans ce bout du monde.
On y entend en particulier l’imparable Nigérien Mdou Moctar et sa voix passée au filtre informatique, qui renvoie autant au rap américain (T-Pain, Kanye West) qu’à des productions nigérianes elles-mêmes nourries par le cinéma indien.
Plus loin, surgissent un reggae à l’origine non identifiée et quelques incursions dans le coupé-décalé ivoirien, mais c’est surtout la musique ishumar qui domine les débats. «Dans le téléphone d’un gamin de Kidal, 80% de ce qu’il écoute vient de la région», estime Chris Kirkley, et cette musique n’appartient qu’au Sahel, comme le détaille l’ethnomusicologue Anouck Genthon, qui raconte dans un livre paru l’an dernier (1) l’odyssée d’un style qui s’est forgé dans le conflit. «Tout part de la décolonisation de l’Afrique française dans les années 60, qui a instauré des frontières fermées, une nouveauté absolument pas inhérente à la culture des Touaregs, qui circulent au nord du Mali, l’ouest du Niger, un bout du Burkina Faso… De plus, les nouveaux Etats malien et nigérien ont rejeté cette population nomade, qui s’est retrouvée stigmatisée de façon croissante. Deux sécheresses [en 1970 et 1984, ndlr] ont ensuite achevé d’appauvrir les Touaregs en décimant les troupeaux, et provoqué l’exode des jeunes hommes», aussi bien pour gagner de quoi faire vivre une famille que pour alimenter une rébellion contre Bamako et Niamey, depuis la Libye et le sud de l’Algérie. C’est là, dans des camps isolés, que des groupes d’hommes ont «commencé à utiliser le répertoire traditionnel, où la musique est normalement dévolue aux femmes, avec des instruments de substitution».
Ce sera un temps la guitare-bidon, où les cordes sont de vieux fils électriques, puis la guitare acoustique, et enfin l’électrique. Une nouvelle forme musicale naît dans ces conditions spartiates, qui partage une gamme pentatonique avec le blues américain et scelle dans son expression collective, sans leader, les revendications indépendantistes des Touaregs. Chantée en tamasheq, la musique ishumar est une mélopée d’oubli où un motif rythmique (souvent un claquement de mains) se retrouve enluminé par des guitares précises et désespérément romantiques. Il n’y a jamais de sursaut dans ce tortueux écoulement poétique, qui étend lentement sa transe dans des morceaux qui – sur scène notamment – peuvent ne jamais avoir de début ni de fin.
Du combat politique à l’indépendance stylistique
Ces groupes dispersés finiront par abandonner leurs armes au milieu des années 90, laissant alors leurs airs se déposer comme une traînée de sable dans la culture touareg, alors déjà largement sédentarisée. Le collectif le plus emblématique de la musique ishumar, Tinariwen, se scindera avec la création de Terakaft.
De cette première racine à deux branches naîtront les deux décennies musicales suivantes dans la région. Ce qu’on entend dans Music from Saharan Cellphones, comme dans les disques publiés par le label français Reaktion Records, est l’héritier direct de cette genèse sonore, qui s’est progressivement éloignée de la politique à mesure que la tentative de créer un Etat touareg s’éteignait.
La musique ishumar y a gagné son indépendance stylistique. Anouck Genthon y discerne ainsi «deux courants principaux» : «Le premier conserve un lien très fort avec la musique ishumar des origines, celle de Tinariwen, avec des textes très poétiques. Ils l’étaient déjà à l’époque de la rébellion, mais la poésie était codée pour ne parler qu’aux Touaregs. C’est notamment la voie suivie par le Nigérien Koudédé [décédé fin 2012 dans un accident de la route entre Ouagadougou et Niamey, ndlr], qui a fait un travail pointilleux pour que le texte prime sur la musique.» L’autre courant, plus volontiers iconoclaste, est celui personnifié par Bombino, Mdou Moctar ou Tarbiyat, «qui tentent de se départir des contraintes historiques pour faire une musique plus directement festive. Mdou, par exemple, joue très fort sur scène, tellement fort qu’on n’entend parfois pas ses paroles. Ce qui compte, c’est l’énergie».
Classiques ou plus aventureux, les musiciens ishumar partagent toutefois un fond identitaire affirmé. «Leur musique est l’une des strates de l’appartenance touareg», analyse Anouck Genthon. «Chacun a dans sa famille quelqu’un qui a été déplacé ou engagé dans la rébellion», confirme Amina Ixa-Graille, une Parisienne qui a longuement vécu au Niger et échange avec ses amis sur Facebook les vidéos des nouvelles stars du genre, le Nigérien Bombino en tête, qui sortira en avril un album enregistré à Nashville par un membre des Black Keys, une formation rock américaine très à la mode.
Comme les groupes Tinariwen, Terakaft ou Tamikrest avant lui, le jeune homme d’Agadez – que Christopher Kirkley a également retrouvé dans les téléphones du Sahel – fait aujourd’hui le grand saut vers l’Occident, à la recherche de moyens de production et de revenus que son pays ne peut lui fournir : parvenir à taper dans l’œil d’un producteur américain ou européen, c’est la garantie de tournées internationales. Mais la donne est sensiblement différente désormais, tant les grandes heures de la world music semblent s’éloigner. Enfin, diront certains.
Le contre-pied d’une world music paternaliste
Dans les années 80 et 90, de nombreux producteurs occidentaux ont en effet exploité une idée à outrance : proposer aux publics de Paris, Londres ou New York un exotisme balisé, d’origine mais jamais trop escarpé, quitte à entretenir quelques clichés. Pour les musiciens eux-mêmes, les retombées financières ont construit des empires, mais la musique a pourri sous le vernis. Le label Real World de Peter Gabriel fut notamment le symbole de cette époque. «Le formatage entrepris par la world music a limité le champ de lecture de la musique africaine, regrette le Mauritanien Monza. Mais, nous avons, dans toute l’Afrique de l’Ouest, une génération qui a, grâce à Internet, les moyens de se faire connaître et entendre pour ce qu’elle est réellement.»
Cet idéalisme doit toutefois être relativisé, car le rêve d’une carrière hors d’Afrique reste très puissant, quand bien même il faudrait abandonner un peu de caractère artistique au passage. De même, les musiques du Sahel circulent avant toute chose dans leur région et dans la diaspora, et se révèlent difficiles à pister pour qui n’a pas la clé d’entrée. Les sélections de Kirkley en sont une, prolongées par des publications sur son label Sahel Sounds. Le travail de Reaktion en est une autre, qui cherche à témoigner au plus juste des dernières variations stylistiques. La maison de disques américaine Sublime Frequencies, qui mène aussi un travail d’enregistrement sur le terrain depuis quelques années, a publié les Nigériens Group Inerane. Mais Sedryk, le créateur de Reaktion Records, «n’adhère pas à leur vision qui veut que si un groupe a un son pourri, il faut que l’enregistrement le soit aussi. Si ces groupes utilisent des instruments fatigués, c’est qu’ils n’ont pas les moyens d’avoir autre chose. On peut leur permettre d’enregistrer correctement sans pour autant leur imposer un son qui n’est pas le leur».
La guerre : un coup de projecteur imprévu
En réaction presque frontale contre la vision paternaliste de la world music, un nouvel équilibre se met lentement en place depuis quelques années au fil des initiatives. La musique ishumar mute, absorbe comme une éponge le hip-hop, le r’n’b ou le kuduro angolais, tout en réussissant à conserver son caractère et son histoire, sur lesquels le conflit en cours dans le nord du Mali vient mettre un coup de projecteur imprévu. «Cette guerre sans images est bizarrement une opportunité, estime Arnaud Contreras. Les médias se tournent vers les artistes pour trouver des choses à raconter. Le problème, c’est qu’on demande à des gens du Sud, comme Fatoumata Diawara, de parler pour le Nord», alors que les deux sphères musicales s’entremêlent très peu, reproduisant une vieille distance culturelle et politique loin d’être comblée. «Mais les Ishumars sont réticents à s’engager médiatiquement, parce qu’ils ont trop souffert de l’amalgame nomades = islamistes, parce que leur musique ne soutient que la paix désormais, et parce qu’ils ont peur des représailles une fois rentrés chez eux, dans des zones où les groupes armés sont encore présents», estime Anouck Genthon.
L’année passée a en effet été particulièrement éprouvante pour les artistes. «Le leader du groupe Amanar, de Kidal, a été chassé de la ville par les islamistes, son matériel détruit, et on l’a menacé de lui couper les doigts s’il revenait. Quant aux Tinariwen, ils ne veulent plus partir en tournée, de peur d’être séparés de leur famille», raconte Sedryk, qui a ces dernières semaines beaucoup échangé avec les artistes qu’il publie. D’autres ont, comme une grande partie de la population, rejoint des camps de réfugiés au Burkina Faso.
Là, la musique continue de scander la vie quotidienne, portant en elle autant de nostalgie que d’espoir dans le futur. Internet et le travail de quelques défricheurs, conscients qu’il faut rétablir un équilibre dans les rapports entre le Nord et le Sud, nous donnent pour la première fois l’occasion de l’entendre telle qu’elle existe vraiment dans les téléphones des habitants du Sahel.
1) «Musique touarègue : du symbolisme politique à une singularisation esthétique», l’Harmattan, 2012.
http://next.liberation.fr/musique/2013/03/01/le-sahel-en-musicolor_885656